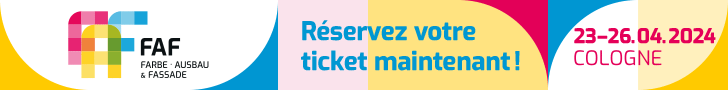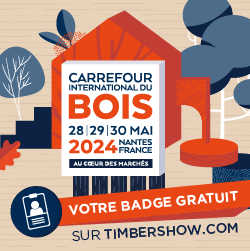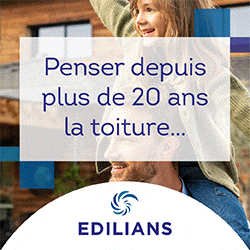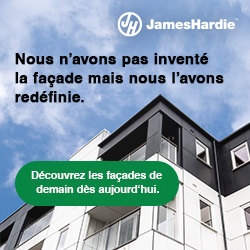Les sécheresses répétées pourraient devenir l’ennemi n°1 des forêts tempérées et provoquer un changement radical de ces milieux d’ici 50 à 100 ans. Pour donner des solutions à la filière forêt-bois et gérer durablement cette ressource, l’Inra mène plusieurs recherches et a publié un dossier complet. Cent ans est l’âge moyen d’exploitation d’un arbre, il faut donc agir dès maintenant. Il est quasiment certain que les changements climatiques auront des impacts négatifs pour les forêts de feuillus et de conifères partout en France. Les arbres à feuilles caduques devraient mieux résister car ils préservent plus les réserves d’eau du sol, notamment en hiver. La perte de leurs feuilles évitant l’évapotranspiration et permettant à l’eau de pluie de nourrir les réserves du sol. Une sylviculture économe en eau et ajustée en fonction des réservoirs aquifères des sols est la voie à privilégier. Par ailleurs, les chercheurs qui ont classé les espèces en grands groupes bio-géographiques, ont constaté la progression des groupes méditerranéens et du sud-ouest comme le chêne vert, accompagnée d’une régression des groupes montagnards comme le hêtre. Ils ont également constaté que les arbres les plus performants en termes de croissance seraient les plus fragiles en cas de sécheresse. Les critères de sélections sylvicoles basés aujourd’hui sur des objectifs de productivité devraient trouver un compromis entre la performance de croissance et la résistance. Afin de déterminer l’évolution possible d’un écosystème forestier, il faudra trouver pour chaque espèce les gènes susceptibles de procurer un avantage adaptatif. Devant ce travail de titan, 25 laboratoires provenant de 15 pays européens se sont mobilisés entre 2006 et 2010. Si la diversité génétique à l’intérieur d’une espèce est très importante pour l’adaptation, le rôle fonctionnel de la diversité des espèces dans l’écosystème l’est tout autant. Les chercheurs de l’Inra l’ont illustré en étudiant les effets de l’introduction d’îlots de feuillus au milieu d’un peuplement pur de pin maritime. La présence de feuillus permet de faire chuter le niveau d’infestation des pins par leurs pires ennemis : la pyrale du tronc et la processionnaire du pin. Suite aux deux tempêtes survenues à dix ans d’intervalle, le massif landais est devenu le plus gros chantier de nettoyage-reboisement d’Europe. Il va être le cadre d’une expérience de reboisement en grandeur réelle. Une prospective menée conjointement par le Conseil régional d’Aquitaine et l’Inra examine les futurs possibles des Landes de Gascogne et rendra ses conclusions en octobre 2011. « En réunissant toute la gamme des acteurs – propriétaires, coopératives, collectivités territoriales, industriels, habitants -, explique Olivier Mora de la Délégation à l’expertise scientifique collective, à la prospective et aux études de l’Inra, cette prospective considère le massif des Landes de Gascogne non pas seulement du point de vue de la filière-bois, mais comme un territoire avec toutes ses composantes : enjeux démographiques, résidentiels, touristiques, énergétiques, climatiques. L’élaboration de scénarios pour 2050 montre qu’il faut faire des choix clairs qui engagent sur le long terme. L’introduction d’îlots ou de lisières de feuillus par exemple, étudiée depuis longtemps mais jamais mise en œuvre dans les Landes, est symbolique des tensions, mais aussi des complémentarités possibles, entre intensification et biodiversité. Sa mise en place suppose une forte coordination entre les acteurs ». Pour télécharger l’ensemble du dossier…